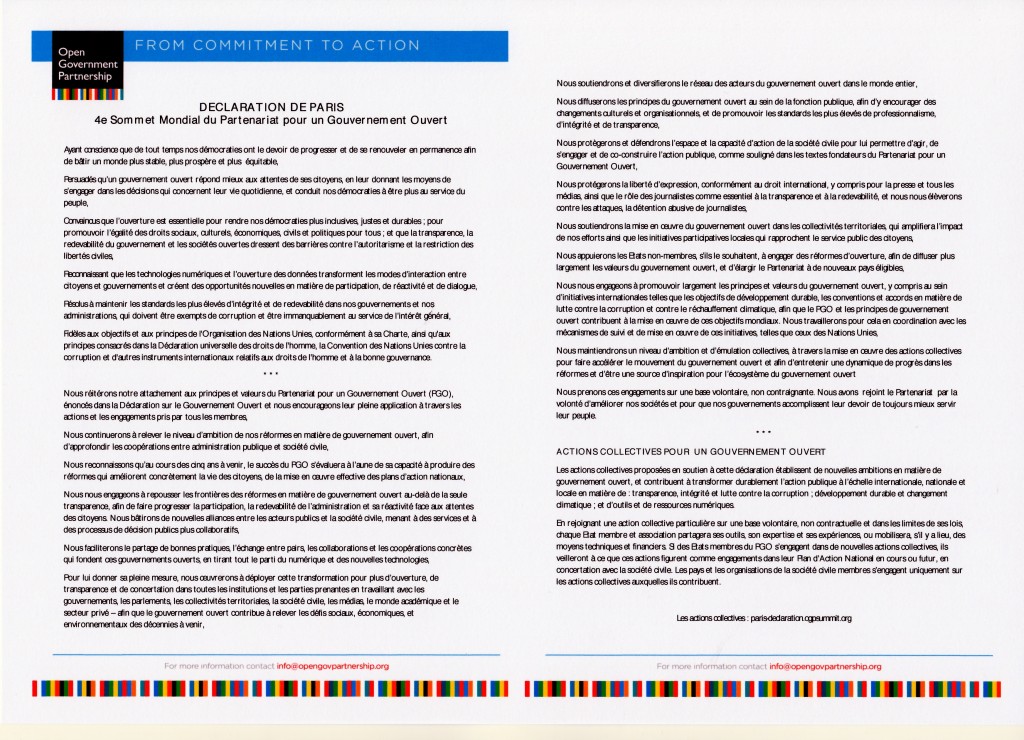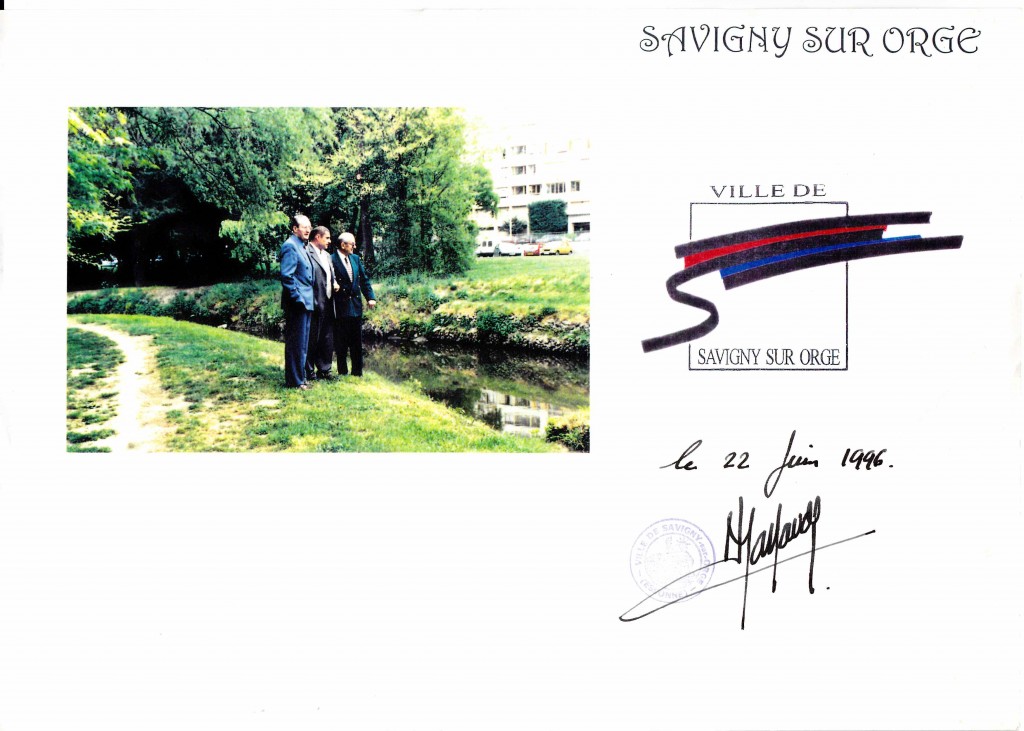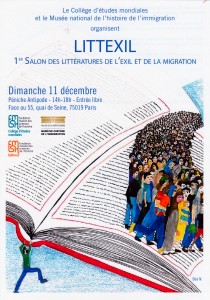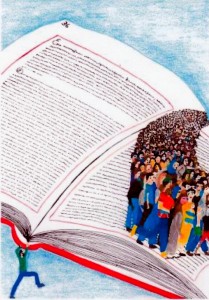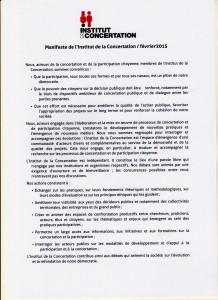LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°228, lundi 26 décembre 2016
Bernard MÉRIGOT a reçu les remerciements du Secrétariat général du Somment mondial de Paris du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) qui s’est tenu les 7, 8 et 9 décembre 2016 pour sa participation. Il répond à nos questions.
 Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)
Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO)
Sommet mondial, Paris, 7, 8 et 9 décembre 2016
Question. Qu’est-ce que le « gouvernement ouvert » ?
Bernard MÉRIGOT. Le gouvernement ouvert (on parle aussi de démocratie ouverte, en anglais : « open government ») est une doctrine d’exercice du pouvoir politique qui vise à améliorer l’efficacité et la responsabilité des modes de gouvernance publique. Elle se fonde sur le principe que tous les citoyens ont le droit d’accéder aux documents et aux procédures de leurs gouvernements et des différentes administrations et services publics. Pour cela elle favorise une transparence et une responsabilisation accrue de toutes les décisions publiques afin de donner aux citoyens les moyens nécessaires pour contrôler, superviser et prendre part aussi bien aux décisions gouvernementales qu’aux décisions locales.
LES TROIS OBJECTIFS
DU « GOUVERNEMENT OUVERT »
Question. Quels en sont ces objectifs ?
Bernard MÉRIGOT. Les objectifs de cette ouverture de la démocratie sont la transparence, la participation citoyenne, la collaboration.
- la transparence est le garant de la confiance que les citoyens portent à l’égard de l’exercice des pouvoirs politiques. Par exemple par la publication des données publiques dans le cadre d’une stratégie de données ouvertes, ou par l’utilisation de logiciels libres par l’administration.
- la participation citoyenne incite le gouvernement à consulter et à écouter les citoyens avant la prise des décisions en mettant en place des dispositifs de concertation et de co-décision avec eux.
- la collaboration avec les composantes de la société civile réalise pour une meilleure efficacité des modes de gouvernance.
LA THÉORIE DE LA FRAGILITÉ DE LA DÉMOCRATIE
DE FRANÇOIS HOLLANDE
Question. Quels messages peut-on retenir du Sommet mondial de Paris de 2016 ?
Bernard MÉRIGOT. D’abord une remise en cause de l’évidence du régime démocratique. Le président de la République, en prenant la parole lors de ce sommet mondial, a constaté que nous nous trouvions dans une période où la démocratie apparaissait selon deux aspects : « elle est fragile et on a le sentiment qu’elle est précieuse ». Les deux sentiments manifestent deux inquiétudes différentes. Exemple : je conduis un véhicule automobile sur la route. Première inquiétude : pourvu que l’embrayage ne lâche pas. Seconde inquiétude : comment je vais faire si ma voiture tombe en panne ?
Le président de la République argumente son propos à partir d’une observation : « Ce qui se produit dans le monde à travers des contestations multiples, des extrémismes de toutes formes et parfois même des expressions venant des responsables publics, montre qu’elle n’a rien d’acquise, qu’elle n’est pas installée définitivement. » Il s’agit d’une remise en cause du caractère « naturel » que la démocratie a acquit aujourd’hui en France. La démocratie n’est pas installée définitivement. Il souligne que « La démocratie, c’est un combat, c’est un mouvement qui doit s’entretenir. C’est quand la démocratie croit qu’elle est une évidence qu’elle ne suscite que de l’indifférence. »
LA DÉMOCRATIE DE L’INDIFFÉRENCE
Nous vivons sans nous en rendre compte, dans une forme particulière de la démocratie : la démocratie de l’indifférence. Celle des secrets, de la confiscation du pouvoir, de la méfiance des élus et des administrations à l’égard des citoyens. Et retour, les citoyens se méfient des élus et des administrations. François HOLLANDE déclare :
« Il y a des signes qui nous alertent depuis longtemps : l’abstention aux élections, le retrait civique d’une partie de la jeunesse, la montée des populismes, et le sentiment que la démocratie ne serait pas forcément le système le plus efficace pour préparer l’avenir. Il y a une forme de lassitude dans les démocraties qui sont installées depuis longtemps, depuis deux ou trois siècles, et puis il y a aussi, dans les pays plus émergents, l’idée que la démocratie ne serait pas forcément le point ultime d’aboutissement de leur développement. Et il y a ce qui altère la démocratie : la corruption mais également les manquements aux libertés essentielles, au pluralisme. »
Reprenons la liste des symptômes :
- abstention aux élections,
- retrait civique d’une partie de la jeunesse,
- montée des populismes,
- sentiment que la démocratie n’est pas forcément le système le plus efficace pour préparer l’avenir,
- lassitude dans les démocraties installées depuis deux ou trois siècles,
- idée que la démocratie ne serait pas forcément le point ultime d’aboutissement le développement dans les pays plus émergents,
- corruption
- manquements aux libertés essentielles et au pluralisme.
 Une démocratie déchirée ? « Il y a une forme de lassitude dans les démocraties qui sont installées depuis longtemps, depuis deux ou trois siècles, et puis il y a aussi, dans les pays plus émergents, l’idée que la démocratie ne serait pas forcément le point ultime d’aboutissement de leur développement. Et il y a ce qui altère la démocratie : la corruption mais également les manquements aux libertés essentielles, au pluralisme. ». François HOLLANDE, président de la République.
Une démocratie déchirée ? « Il y a une forme de lassitude dans les démocraties qui sont installées depuis longtemps, depuis deux ou trois siècles, et puis il y a aussi, dans les pays plus émergents, l’idée que la démocratie ne serait pas forcément le point ultime d’aboutissement de leur développement. Et il y a ce qui altère la démocratie : la corruption mais également les manquements aux libertés essentielles, au pluralisme. ». François HOLLANDE, président de la République.
© Photo CAD / BM 2016
LES « INTERVENTIONS CIVIQUES »,
SONT UN MESSAGE D’ESPOIR
Question. Quels peuvent-être les remèdes à la démocratie de l’indifférence ?
Bernard MÉRIGOT. Ce qui importe, davantage que la nature des remèdes, c’est de savoir qui est susceptible de les administrer au malade. François HOLLANDE ne croit pas que cela puisse être, ni les élus, ni les administrations : il ne les cite pas. En revanche, il mentionne les « interventions civiques » et les « mobilisations citoyennes ». Pour lui, il s’agit de « messages d’espoir ». Ensuite il évoque les « développeurs bénévoles qui mettent à la disposition de leur administration des outils de transparence pour lutter contre la corruption ».
Comment permettre à tous les citoyens de comprendre précisément ce que représente la dépense publique et où elle va ? Le numérique a produit un changement profond dans la relation entre l’État et les citoyens, des outils nouveaux, pour qu’une nouvelle démocratie puisse émerger.
Le président de la République appelle de ses vœux « une démocratie où l’État, les administrations, les collectivités publiques s’ouvrent à toutes les initiatives, associent tous les talents qui souhaitent apporter leur concours, où l’innovation soit partout présente pour améliorer la performance publique mais également la compréhension de l’action de ceux qui ont reçu mandat des peuples pour prendre des décisions. »
« Une démocratie qui garantit que les gouvernements, les élus, les responsables sont bien au seul service de l’intérêt général ; qu’ils sont intègres, responsables, qu’ils rendent des comptes, que l’on puisse évaluer leur action et qu’ils puissent ensuite avoir la fierté de pouvoir dire la trace qu’ils ont pu laisser et les engagements qu’ils ont pu tenir. Une démocratie, qui suscite la confiance et qui écarte donc l’indifférence et la défiance. »
« Cet engagement pour une démocratie plus transparente, plus ouverte, plus participative fait partie de ce que doit être un engagement pour la politique, pour lui donner toutes ses ambitions, pour lui donner aussi toute sa fierté, pour la réhabiliter aux yeux de nos concitoyens, pour montrer qu’elle est un engagement et qu’elle n’est pas simplement une promotion.»
Il y a une phrase sur laquelle il faut s’arrêter « une démocratie qui n’est pas simplement une promotion ». Il est vrai que le citoyen, victime de l’indifférence de nombre d’élus et de fonctionnaires, est un sentiment que l’exercice des fonctions exécutives au sein des machines du pouvoir, placent ses acteurs non pas au niveau des contribuables, des usagers, des habitants mais au-dessus d’eux. Les pratiques qui relèvent de la violence symbolique volontaire ne sont plus tolérables.
SCÉNARIO CATASTROPHE POUR LA DÉMOCRATIE
« Si la démocratie n’est pas renouvelée, si elle n’est pas revisitée, si elle n’est pas appropriée par les citoyens eux-mêmes, son dépérissement est possible et sa contestation ne finira pas de monter. »
« Les populistes s’empareront de tout ce qui fait frustration, colère ou insatisfaction. Ils joueront même avec les réseaux sociaux et le numérique pour diffuser de la fausse information, pour essayer de rendre équivalentes les opinions, pour contester celles et ceux qui sont issus du suffrage universel, pour considérer qu’il y a en réalité un autre système que celui qui donne au peuple les moyens de se faire entendre.»
LE RENVERSEMENT HOLLANDAIS
Il existe un renversement hollandais de la gouvernance. « Ce que nous devons faire, ce n’est pas défendre la démocratie comme si elle était attaquée et nous barricader derrière nos institutions, c’est tout le contraire : nous devons nous ouvrir, nous devons être transparents, nous devons montrer que nous sommes accueillants à toutes les initiatives, que les administrations, les États n’ont rien à craindre des citoyens et les citoyens ont tout à espérer des États dès lors qu’ils les respectent. »
Question. A la veille de l’ouverture du Sommet mondial, plusieurs associations dans un texte commun intitulé « Le gouvernement ouvert à la française, un leurre ? Bilan du gouvernement ouvert à la française ». (3) Il est co-signé par les associations et collectifs : April, BLOOM, DemocracyOS France, Fais ta loi, Framasoft, La Quadrature du Net, Ligue des Droits de l’Homme, Regards Citoyens, République citoyenne, SavoirsCom1. Elles dénoncent les contradictions du gouvernement à l’égard du « gouvernement ouvert ». Certaines n’y ont pas assisté. Qu’en pensez-vous ?
Bernard MÉRIGOT. Il est évident que la démarche du Partenariat pour un gouvernement ouvert se situe sur une ligne de tension entre les pouvoirs en place et les attentes citoyennes, qu’elles soient individuelles ou collectives. Il y a plusieurs marches qui séparent les déclarations politiques et les pratiques auxquelles les citoyens sont confrontés. Il est normal que des contributions, des observations, des réserves et des critiques s’expriment. Si les pratiques doivent être analysées, il en est de même pour les discours du pouvoir. On ne peut pas réserver un sort différent aux unes (les pratiques) et pas aux autres (les discours).
Question. Si on vous objecte que les propos tenus par François HOLLANDE, qui est socialiste, n’engagent que lui, que répondez-vous ?
Bernard MÉRIGOT. Cette question est fondée sur une erreur d’appréciation. Lorsqu’un chef d’État prend la parole dans un sommet mondial, il n’intervient pas en tant que personne politique partisane, mais en tant que Président de la République. Il engage l’État tout entier. Son propos s’impose à tous. Et d’autres candidats aux prochaines élections présidentielles françaises ne sauraient dire le contraire de ce que François HOLLANDE a énoncé : la démocratie ne se porte très bien.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le 7 décembre 2016, lors du Sommet mondial de Paris du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), le président de la République française a livré un diagnostic sur la situation de la démocratie, sur ses maladies, sur leurs causes, sur les moyens pour remédier à ce qui altère sa bonne santé. Il a pris des engagements, devant le monde entier. Cela ne saurait être ni passé sous silence, ni caricaturé.
François HOLLANDE a été élu en 2012 pour un mandat de cinq ans (2012- 2017). Le décembre 2016 il a annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle de 2017. Il se trouve dans la situation d’un président élu, exerçant le pouvoir pour six mois et dont le mandat prendra fin, de façon certaine, en juin 2017. Il jouit d’une liberté de parole inédite. En fait-il usage ? Pour ma part je remarque qu’il a entrouvert quelques portes. A d’autres de les ouvrir complétement.
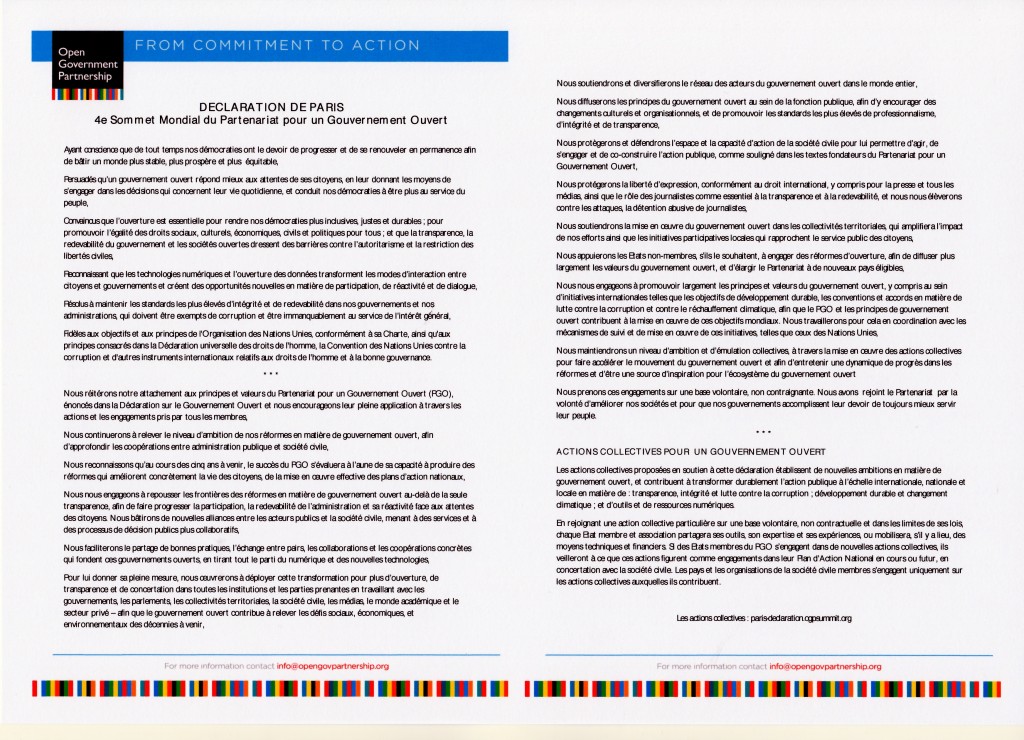 Open Government Partnership, Paris, 2016
Open Government Partnership, Paris, 2016
«Déclaration de Paris», 4e Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert.
DOCUMENT n°1
Mail adressé par le Secrétariat général du Somment mondial de Paris du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) le 23 décembre 2016 à Bernard MÉRIGOT, Président de Mieux Aborder L’Avenir (MALA).
Au nom de l’ensemble du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État et de la mission Etalab, nous tenons à vous remercier pour votre participation au Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), qui s’est tenu du 7 au 9 décembre 2016 à Paris.
Cette rencontre inédite des acteurs de l’innovation démocratique du monde entier a été un succès : près de 4000 participants, 140 nationalités représentées, plus de 300 événements. Cette énergie n’aurait pas été possible sans votre engagement dans la préparation de cet événement et votre présence pendant ces trois jours.
Ce Sommet a permis d’enregistrer des réalisations concrètes :
-
10 nouveaux pays ont rejoint ou exprimé l’intention de rejoindre le Partenariat pour un gouvernement ouvert. En tant que co-présidente du PGO, la France s’attachera à accompagner l’adhésion de plusieurs membres, notamment les pays francophones ;
-
Au sein de la Déclaration de Paris, la France a annoncé sa contribution à 14 actions collectives, englobant des enjeux allant de la transparence de la commande publique au partage de ressources numériques. Ces actions se déclineront sans doute au sein du plan d’action national 2017-2019, dont l’élaboration et la mise en œuvre associeront une communauté élargie d’administrations et de représentants de la société civile ;
-
Une plateforme numérique d’outils et services du gouvernement ouvert a été mise en ligne et enrichie par une communauté mondiale de développeurs et d’innovateurs. Cette plateforme permet de relier directement des engagements d’ouverture avec des outils de mise en œuvre.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2017 pour prolonger nos actions.
Laure de la Bretèche
Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP)
Henri Verdier
Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC)
Laure Lucchesi
Etalab
DOCUMENT n°2
Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert
Discours de François HOLLANDE
Président de la République
Mercredi 7 décembre 2016
Mesdames, Messieurs les Chefs d’État, de gouvernement,
Mesdames, Messieurs les représentants de nombreux pays qui se sont associés à ce sommet pour le gouvernement ouvert,
Mesdames, Messieurs les Élus, les citoyens organisés – ou pas – qui se sont engagés,
Cher Manish BAPNA, qui co-organise avec nous ce sommet.
Je suis heureux de vous accueillir ici, à Paris, pour cet événement international. Je rappelle qu’il avait été lancé par Barack OBAMA – c’est pourquoi il sera émouvant et utile de l’entendre quand il s’exprimera devant vous.
Mais en même temps, ce sommet vient après d’autres qui ont pu ouvrir d’autres champs pour la participation civique et pour donner aux citoyens davantage de moyens de faire entendre leur voix ou même de changer la décision publique. Ces sommets ont également fait pression sur les gouvernements pour qu’ils soient plus ouverts sans doute, plus transparents sûrement et, en même temps, plus contestés chaque fois qu’ils pouvaient mettre en cause un certain nombre de relations entre les États et les citoyens.
Ce sommet se tient dans un contexte particulier. Je ne parle pas simplement de la situation dans le monde, des conflits, des crises, du terrorisme. Je parle de ce qui peut menacer la démocratie elle-même. Dans cette période où la démocratie nous paraît fragile et pourtant si précieuse. Ce qui se produit dans le monde à travers des contestations multiples, des extrémismes de toutes formes et parfois même des expressions venant des responsables publics, montre qu’elle n’a rien d’acquise, qu’elle n’est pas installée définitivement.
La démocratie, c’est un combat, c’est un mouvement qui doit s’entretenir. C’est quand la démocratie croit qu’elle est une évidence qu’elle ne suscite que de l’indifférence.
Il y a des signes qui nous alertent depuis longtemps : l’abstention aux élections, le retrait civique d’une partie de la jeunesse, la montée des populismes, et le sentiment que la démocratie ne serait pas forcément le système le plus efficace pour préparer l’avenir. Il y a une forme de lassitude dans les démocraties qui sont installées depuis longtemps, depuis deux ou trois siècles, et puis il y a aussi, dans les pays plus émergents, l’idée que la démocratie ne serait pas forcément le point ultime d’aboutissement de leur développement. Et il y a ce qui altère la démocratie : la corruption mais également les manquements aux libertés essentielles, au pluralisme.
A côté de ce risque d’une démocratie qui pourrait être atteinte dans ses fondements, il y a aussi des messages d’espoir, il y a aussi des interventions civiques, il y a aussi des mobilisations citoyennes et c’est ce que vous représentez ici. Au-delà des chefs d’État et de gouvernement et des ministres qui sont là – que je salue -, il y a des citoyens, des innovateurs, des organisations non gouvernementales, des élus qui se mobilisent pour approfondir et réinventer notre démocratie, et pour que les aspirations des citoyens puissent se faire entendre.
Nous avons aussi des preuves de ce que la mobilisation et la participation civique peuvent donner comme changement : des médias qui mettent à jour des documents révélant une évasion fiscale mondialisée et qui permettent ainsi aux chefs d’État et de gouvernement, dans les organisations internationales, de prendre des mesures pour lutter contre la fraude fiscale ou contre l’optimisation fiscale. Sans ces médias-là, sans ces lanceurs d’alerte, qui peut savoir s’il y aurait eu la pression nécessaire ?
Il y a également des développeurs bénévoles qui mettent à la disposition de leur administration des outils de transparence pour lutter contre la corruption. Il y a des villes, ici, à Paris, mais bien d’autres dans le monde, qui associent directement les habitants à la gestion concrète d’une partie du budget. Il y a des citoyens en Amérique latine, en Europe, en Asie, partout qui sont associés à la fabrique de la loi. Il y a des développeurs qui créent des applications pour permettre à tous les citoyens de comprendre précisément ce que représente la dépense publique et où elle va.
C’est de toutes ces expériences dont nous voulons parler. Ce que le numérique a considérablement fait changer, ce que la digitalisation de nos sociétés a permis comme expression et comme changement profond dans la relation entre l’État et les citoyens.
Vous êtes venus ici, à Paris, pour échanger, dialoguer, construire de nouvelles coalitions, proposer des outils nouveaux, pour que la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens puisse être changée, pour qu’une nouvelle démocratie puisse émerger.
Une démocratie où l’État, les administrations, les collectivités publiques s’ouvrent à toutes les initiatives, associent tous les talents qui souhaitent apporter leur concours, où l’innovation soit partout présente pour améliorer la performance publique mais également la compréhension de l’action de ceux qui ont reçu mandat des peuples pour prendre des décisions.
Une démocratie qui garantit que les gouvernements, les élus, les responsables sont bien au seul service de l’intérêt général ; qu’ils sont intègres, responsables, qu’ils rendent des comptes, que l’on puisse évaluer leur action et qu’ils puissent ensuite avoir la fierté de pouvoir dire la trace qu’ils ont pu laisser et les engagements qu’ils ont pu tenir. Une démocratie, qui suscite la confiance et qui écarte donc l’indifférence et la défiance.
C’est pour fédérer, soutenir toutes celles et tous ceux qui partagent cette vision, pour aller encore plus loin, que le Partenariat pour un gouvernement ouvert a été créé, pour mettre en commun toutes les expériences de nos sociétés. Depuis 2011, bien du chemin a été parcouru : le Partenariat est passé en moins de cinq ans de 8 à 70 pays, il a permis à des dizaines de gouvernements de collaborer avec leur société, il y a eu 2 500 engagements qui ont pu être portés dans 135 plans d’action. Nous ne sommes pas rassemblés simplement pour évoquer ce qu’il faudrait faire, nous sommes déjà là pour évaluer ce qui a été fait.
J’ai voulu d’ailleurs, dès 2012, dès mon entrée en fonction, mettre la France dans ce mouvement pour qu’elle puisse elle aussi apporter sa contribution et montrer de l’exemplarité pour la transparence, pour la participation citoyenne, pour la probité de ses dirigeants, pour l’ouverture de l’administration, pour le partage des données. Pour que la France puisse être là encore, autant qu’il est possible, d’avant-garde.
Ainsi, l’ouverture des données publiques est devenue un principe, elle concerne tous les secteurs de l’action gouvernementale. Une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été créée. 14 000 élus et agents publics doivent communiquer leur déclaration de patrimoine et d’intérêt, celles des parlementaires sont publiées et des règles déontologiques ont pu être fixées et soumises au respect le plus scrupuleux.
Nous avons également adopté une loi qui protège les lanceurs d’alerte, qui encadre les groupes de pression, qui crée un répertoire public et qui institue une agence anticorruption – elle verra le jour au début de l’année prochaine.
Cet engagement pour une démocratie plus transparente, plus ouverte, plus participative fait partie de ce que doit être un engagement pour la politique, pour lui donner toutes ses ambitions, pour lui donner aussi toute sa fierté, pour la réhabiliter aux yeux de nos concitoyens, pour montrer qu’elle est un engagement et qu’elle n’est pas simplement une promotion. Mais nous devons collectivement aller plus loin. C’est le sens du sommet de Paris.
J’ai, pour ma part, trois ambitions en vous accueillant aujourd’hui.
La première, c’est d’élargir notre communauté. Depuis 2011, chaque sommet a vu de nombreux membres rejoindre le Partenariat. Nous serons là encore attentifs à toutes les initiatives qui permettront d’ajouter de nouveaux pays : je pense au Portugal, au Maroc, au Pakistan, au Burkina Faso, à la Jamaïque, au Luxembourg, à l’Allemagne. Les dirigeants de Guinée et d’Haïti ont aussi fait connaître leur intention. Nous voulons que ce processus puisse concerner tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, tous les continents et qu’il puisse également être ouvert aux régions, aux collectivités territoriales, aux villes – et je salue celles qui sont parmi nous.
Ma deuxième priorité, c’est que nous puissions renouveler notre pacte commun. C’est le sens de la Déclaration qui sera publiée à l’issue de ce sommet. Elle reconnaît qu’au cours des cinq ans à venir, notre Partenariat devra être évalué en fonction de notre capacité à produire des réformes qui se concrétisent effectivement dans la vie de nos concitoyens. Chacun devra produire des plans d’action nationaux.
Nous aurons aussi à lancer de nouvelles alliances entre les acteurs publics et la société civile pour faire progresser dans chacun de nos pays la participation des citoyens et l’aptitude de l’administration à rendre des comptes et à être évaluée, également sa rapidité pour transposer, traduire concrètement dans la vie de tous les jours ce qui est décidé par la loi. Nous avons aussi l’ambition d’élargir l’enjeu de la transparence en la mettant au service du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.
Il y a un an, ici, à Paris, dans un autre contexte qui était lourd à cause des attaques terroristes dont mon pays avait été la cible, nous réunissions la COP21 et nous concluions un Accord historique pour l’avenir de la planète. Les engagements qui ont été pris l’année dernière doivent également être évalués : savoir si les fonds promis seront effectivement dégagés, et évaluer les plans, les contributions nationales qui ont été proposées par chacun des pays. Il y a un lien direct entre la conférence de Paris sur le climat et ce sommet pour le gouvernement ouvert. C’est ce sommet pour le gouvernement ouvert qui va permettre là aussi de pouvoir être sûr que ce qui a été déclaré à Paris, ratifié par les pays de la communauté internationale, qui est devenu donc maintenant un engagement, un droit international, puisse être effectivement vérifié et contrôlé.
La Déclaration de Paris affirmera aussi le principe de partage des biens communs numériques afin que la technologie qui permet de faire circuler l’information soit au service de tous et ne soit la propriété exclusive d’aucun intérêt ou d’aucun monopole, qu’il soit privé ou étatique. Nous avons insisté sur l’enjeu du numérique, sur la digitalisation qui est à la fois la forme d’expression, d’intervention, de participation, d’innovation, d’invention, d’imagination mais qui peut être aussi capté par des forces, par des intérêts. Nous devons affirmer ici le partage des biens commun.
Voilà la feuille de route qui devra être fixée par notre sommet et qui nous conduira ensuite à agir concrètement avec toutes les forces vives de la démocratie.
Nous devons enfin, comme nous l’avons fait l’année dernière, envisager des alliances, des initiatives concrètes qui pourront rassembler plusieurs pays : ceux qui voudront aller plus loin en matière de transparence, d’ouverture ou de participation démocratique, qui voudront publier en format ouvert les données de la commande publique, constituer des registres des entreprises, utiliser les données pour mieux lutter contre la corruption, améliorer encore le principe de consultation des citoyens, faire qu’il puisse y avoir sur l’environnement l’utilisation de toutes les données climatiques. Là encore, nous pouvons proposer un agenda des solutions.
Mesdames et Messieurs, voilà ce qu’est notre responsabilité aujourd’hui. Il y a une centaine de pays ici représentés, des milliers d’innovateurs qui se sont mobilisés autour de vous pour que notre organisation puisse être plus forte encore et nous interpeller davantage.
Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre parce que c’est l’enjeu de la démocratie. Si la démocratie n’est pas renouvelée, si elle n’est pas revisitée, si elle n’est pas appropriée par les citoyens eux-mêmes, son dépérissement est possible et sa contestation ne finira pas de monter. Les populistes s’empareront de tout ce qui fait frustration, colère ou insatisfaction. Ils joueront même avec les réseaux sociaux et le numérique pour diffuser de la fausse information, pour essayer de rendre équivalentes les opinions, pour contester celles et ceux qui sont issus du suffrage universel, pour considérer qu’il y a en réalité un autre système que celui qui donne au peuple les moyens de se faire entendre.
Voilà pourquoi notre réunion n’est pas simplement pour échanger des bonnes pratiques, pour susciter des expériences, pour évaluer ce que nous avons pu définir dans chacun de nos pays. Notre responsabilité est bien plus grande. Ce que nous devons faire, ce n’est pas défendre la démocratie comme si elle était attaquée et nous barricader derrière nos institutions, c’est tout le contraire : nous devons nous ouvrir, nous devons être transparents, nous devons montrer que nous sommes accueillants à toutes les initiatives, que les administrations, les États n’ont rien à craindre des citoyens et les citoyens ont tout à espérer des États dès lors qu’ils les respectent.
Ce que nous avons à faire, c’est que les citoyens aient envie de la démocratie et que la démocratie laisse toute leur place aux citoyens. Voilà l’enjeu de ce sommet. Merci.
RÉFÉRENCES
1. Laure de la Bretèche (Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, SGMAP), Henri Verdier (Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État, DINSIC), Laure Lucchesi (Etalab), «Mail en date du 23 décembre 2016 adressé à Bernard MÉRIGOT», Président de Mieux Aborder L’Avenir (MALA).
2. HOLLANDE François, « Discours du Président de la République au Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert, Salle Pleyel, mercredi 7 décembre 2016, Présidence de la République, Service de presse. http://www.opengovpartnership.org/blog/françois-hollande/2016/12/07/discours-du-president-de-la-republique-sommet-mondial-du
3. COLLECTIF, « Le gouvernement ouvert à la française, un leurre ? », Bilan du gouvernement ouvert à la française, co-signé par les associations et collectifs April, BLOOM, DemocracyOS France, Fais ta loi, Framasoft, La Quadrature du Net, Ligue des Droits de l’Homme, Regards Citoyens, République citoyenne, SavoirsCom1, Décembre 2016, 9 p. http://www.20161205-article-pgo.pdf
4. Open Government Partnership, «Déclaration de Paris», 4e Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert, 9 décembre 2016.
Ressources
- Galerie multimédia (vidéos et photos) : https://fr.ogpsummit.org/media-gallery/
- Déclaration de Paris et actions collectives: https://fr.ogpsummit.org/paris-declaration.
- OGP Toolbox : https://fr.ogpsummit.org/the-open-government-toolbox/
Etalab est un service public créé en 2011. Il est chargé de conduire la politique d’ouverture et de partage des données publiques du gouvernement français, de coordonner l’action du gouvernement en vue du gouvernement ouvert et de la mise en œuvre des fonctions attribuées à l’administrateur général des données.
Etalab développe et maintient le portail des données ouvertes du gouvernement français data.gouv.fr. Depuis septembre 2015, la mission Etalab est rattachée à la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP).
La Lettre du lundi de Mieux Aborder l’Avenir
n°228, 26 décembre 2016
Mention du présent article : http//www.savigny-avenir.info
ISSN 2261-1819 BNF. Dépôt légal du numérique, 2016