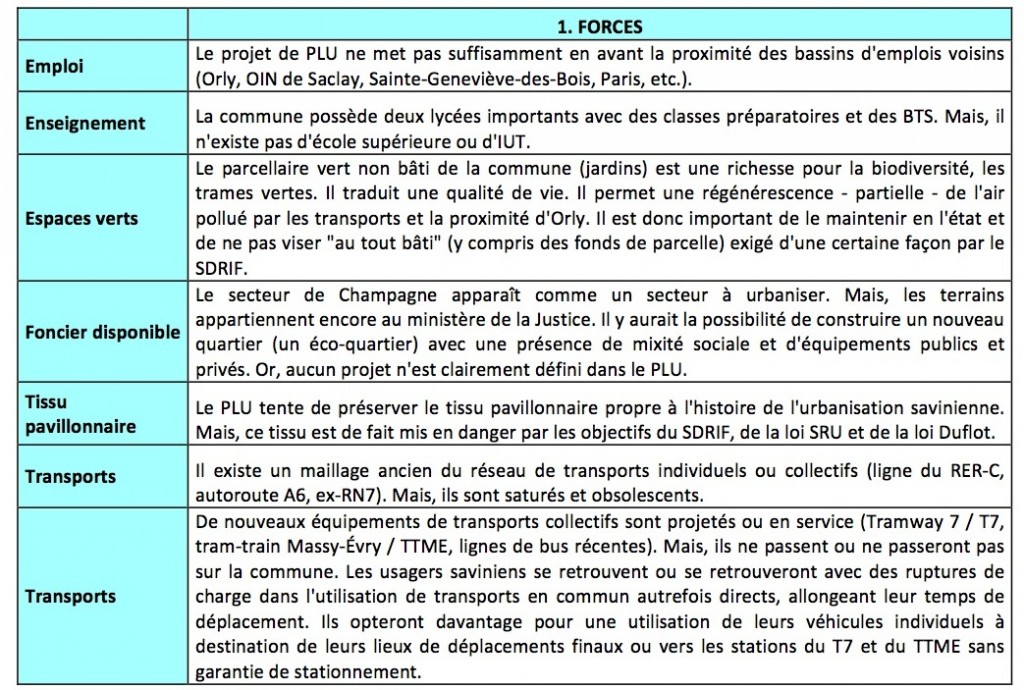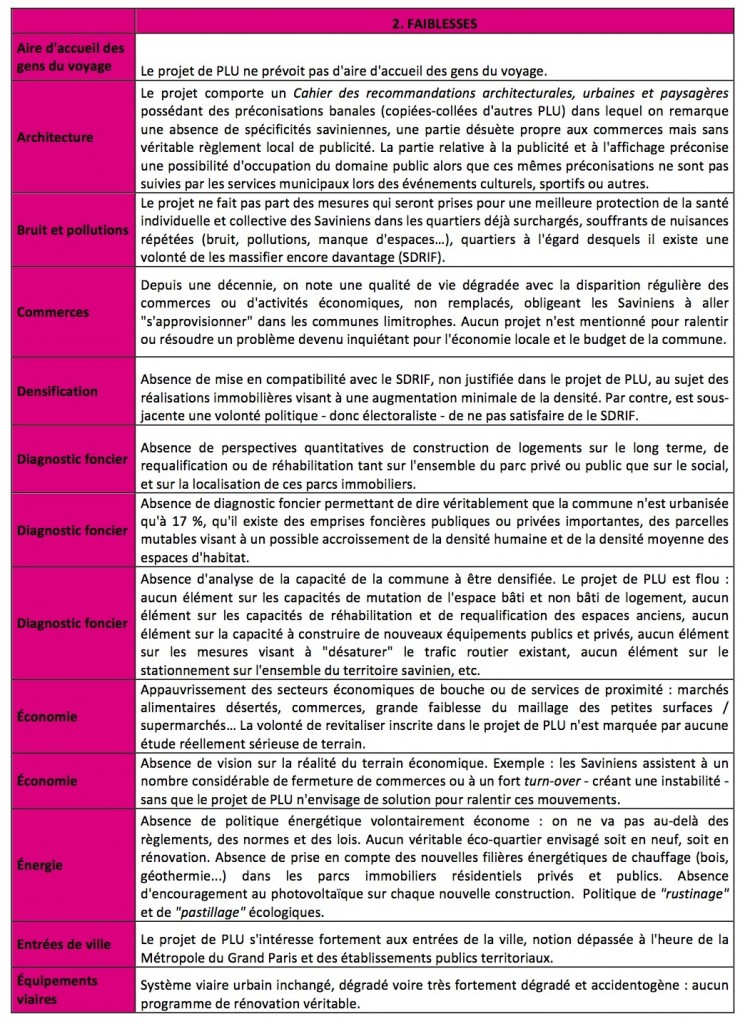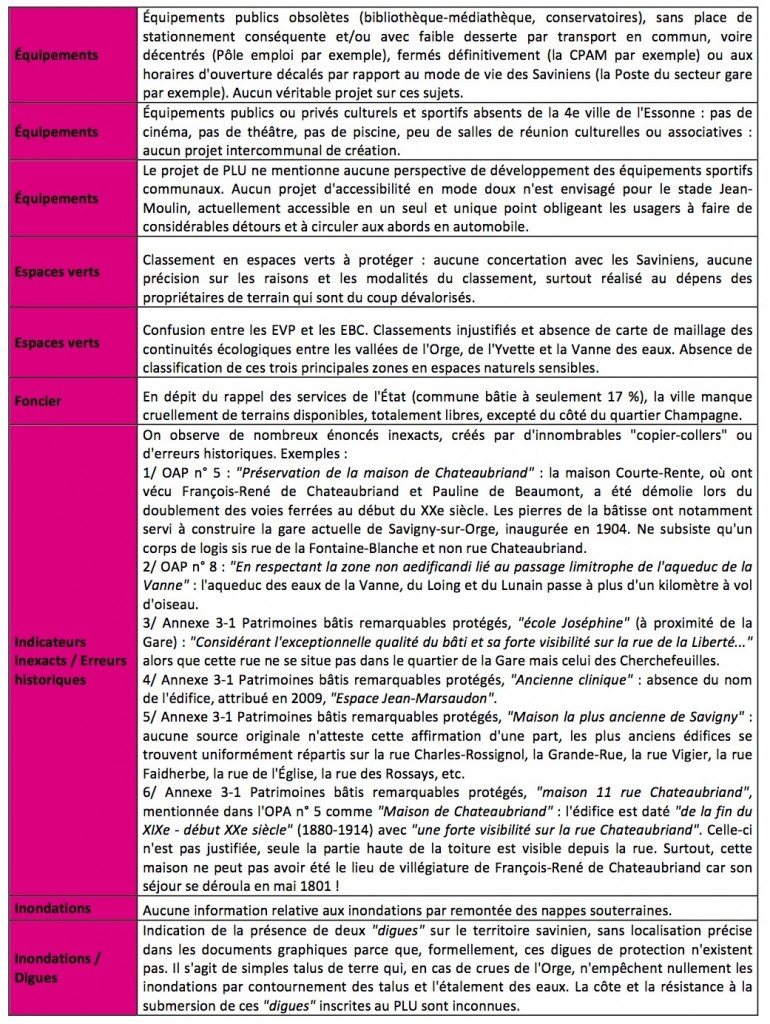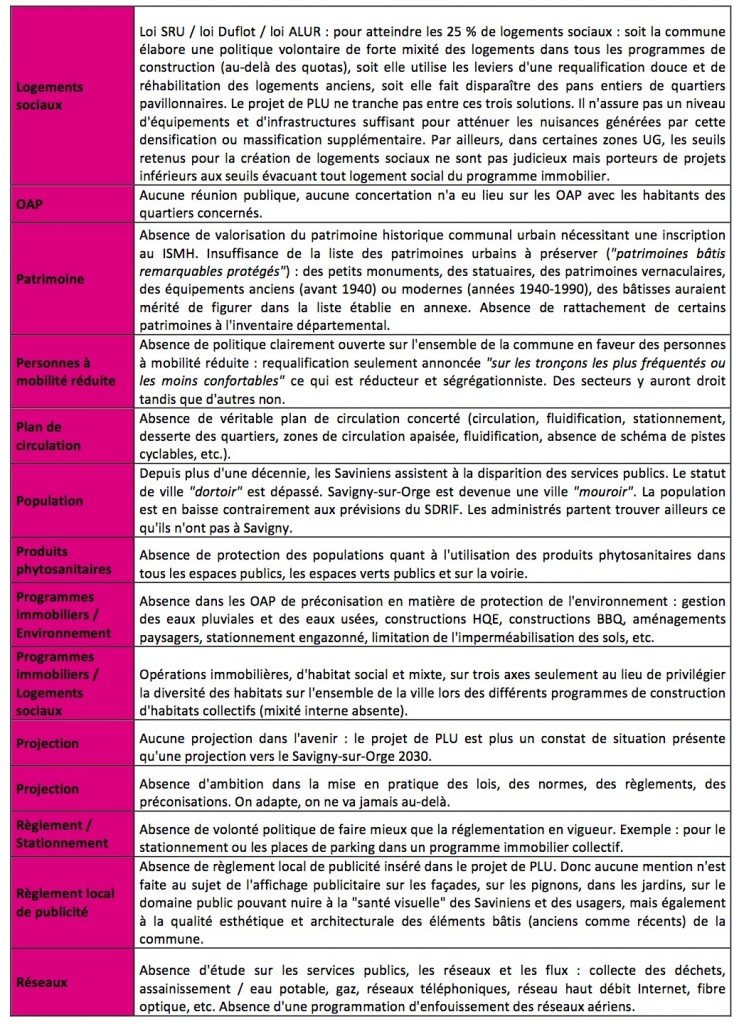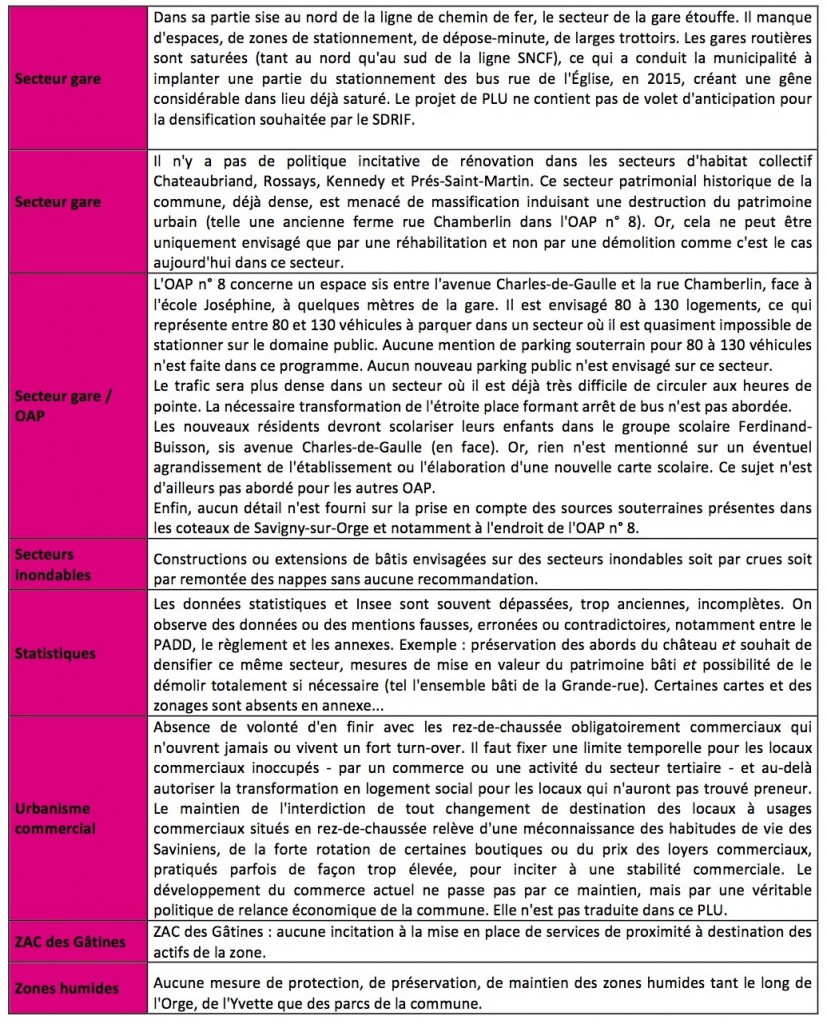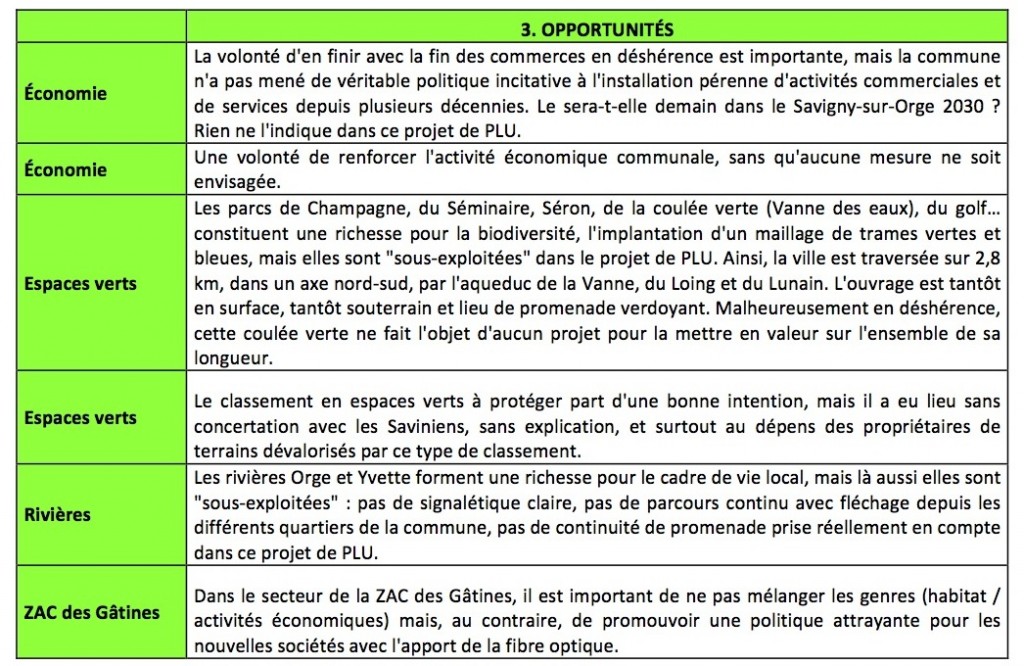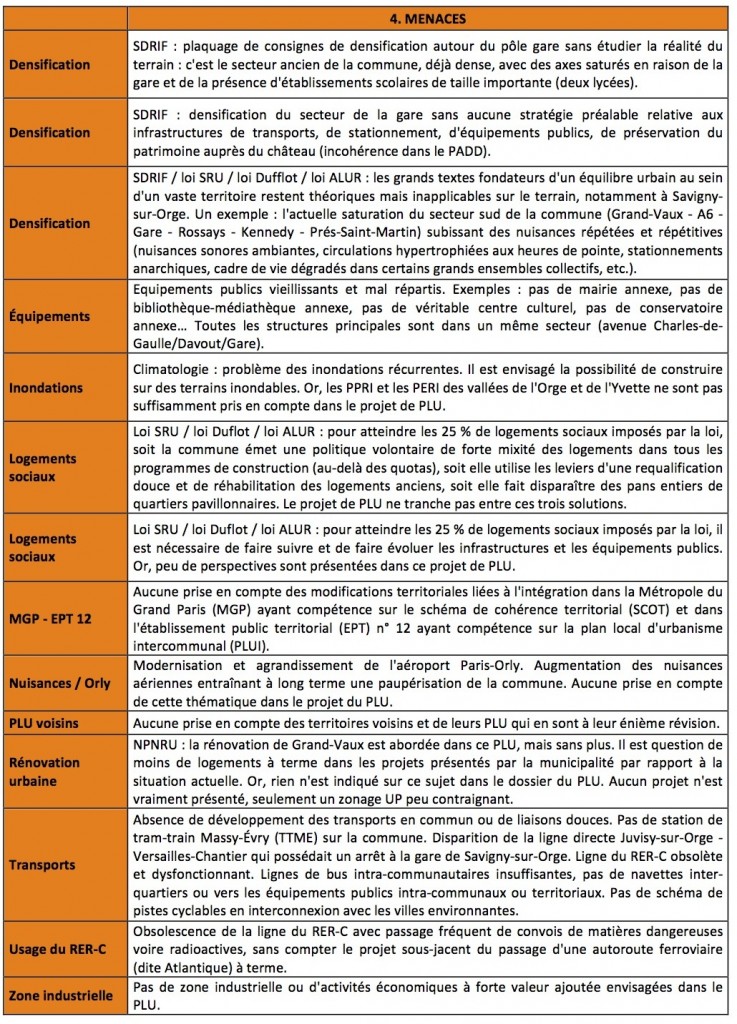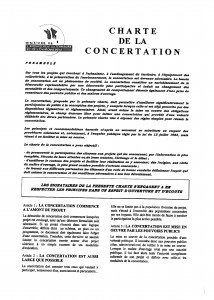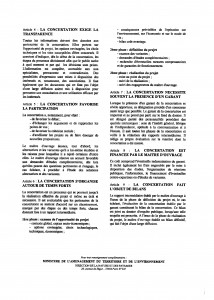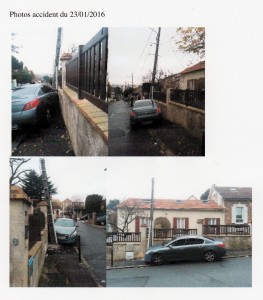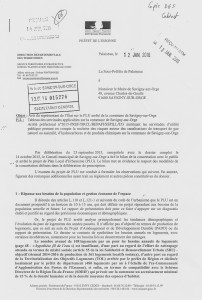LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°184, lundi 22 février 2016
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris (MGP) – et ses douze établissements publics territoriaux (EPT) – regroupent 6 968 051 habitants répartis dans 131 communes, soit la totalité des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, six communes de l’Essonne et une commune du Val-d’Oise.
Cette évolution institutionnelle constitue un bouleversement majeur pour les territoires concernés.
- Quelles sont les forces en présence ? Qu’il s’agisse des hommes : l’État, les fonctionnaires, les administrations, les élus, les fonctionnaires territoriaux… Ou qu’il s’agisse des collectivités locales existantes : conseil régional, conseils départementaux, anciens syndicats intercommunaux, communes… ?
- Quel discours est tenu par l’institution ? Quelles sont les justifications de cette nouvelle organisation ? Quels arguments sont utilisés ?
- Quelle visibilité et quelle intelligibilité les citoyens en ont-ils ?
- Quels sont les dispositifs de concertation et de participation ?
- Quelle distance sépare les annonces des réalisations ?
Autrement dit, une institution et une assemblée délibérante nouvelle peuvent-elles « fabriquer » un territoire nouveau, doté d’une identité nouvelle ?
 Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris (MGP)
Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris (MGP)
lors de la conférence de presse du 18 février 2016
© Photo CAD / BM 2016
LA SYMBOLIQUE POLITIQUE DES LIEUX
L’assemblée délibérante de la Métropole du Grand Paris est constituée par un « conseil de la Métropole » composé de 209 membres élus en novembre/décembre 2015 par ses 131 conseils municipaux. En son sein siègent une très forte majorité de maires qui cumulent la fonction de conseiller métropolitain avec d’autres mandats. Lorsque le législateur a voté la loi créant cette assemblée, il ne s’est pas inquiété du lieu où elle se réunirait. A la Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris de trouver une solution…
Aujourd’hui, la Métropole du Grand Paris loue l’hémicycle du Conseil économique, social et environnemental (CESE) au Palais d’Iéna. Elle y a tenu sa première séance le 22 janvier 2016 au cours de laquelle elle a élu son président, Patrick OLLIER, ainsi que vingt vice-présidents et huit conseillers délégués, formant un exécutif de 28 membres (ce qui représente 13 % de l’effectif total des 209 conseillers territoriaux).
 Conseil de la Métropole du Grand Paris
Conseil de la Métropole du Grand Paris
Séance publique du 18 février 2016
Hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, Palais d’Iéna, Paris
© Photo CAD / BM 2016
Il n’est pas anodin de voir la Métropole du Grand Paris tenir ses séances publiques dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental qui est, rappelons-le, la troisième assemblée constitutionnelle française, après l’Assemblée nationale et le Sénat. Le lieu est symbolique.
La symbolique politique ne porte pas seulement sur le choix du local dans lequel une assemblée délibérante se réunit, mais aussi sur l’ordre selon ses membres s’asseyent. Il faut noter que, lors de la première séance du 22 janvier 2016, les conseillers métropolitains étaient assis par ordre alphabétique. Pour la seconde séance, le 19 février, ils ont siégé selon une répartition par groupes politiques : le PS à gauche, l’UDI au centre, LR à droite.
 La disposition des conseillers métropolitains
La disposition des conseillers métropolitains
lors de la séance publique du 19 février 2016,
Hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, Palais d’Iéna, Paris
© Photo CAD / BM, 2016
LA MÉTROPOLE OU LA RÉGION ?
On connaît les visions différentes exprimées par les deux collectivités, aujourd’hui en concurrence, que sont la Métropole du Grand Paris (Patrick OLLIER) et le Conseil régional d’Ile-de-France (Valérie PÉCRESSE).
Pour Patrick OLLIER, la Métropole est une intercommunalité « qui trouve sa place dans un cadre régional ». Selon lui, opposer Métropole et Région n’a pas de sens.
- La Région possède un exécutif élu au suffrage universel direct. C’est donc une instance politique.
- La Métropole, élu par les conseils municipaux, est une intercommunalité dont la gouvernance associe des communes autour d’un projet commun réunissant 131 communes représentant chacun un territoire, et non une formation politique.
C’est la source de la fameuse culture du consensus de l’intercommunalité. Elle est illustrée par le propos de Patrick OLLIER rapporté par les médias spécialisés dans le Grand Paris : « Nous mettons nos sensibilités de côté pour œuvrer ensemble dans le sens de l’intérêt général ». (1) Le consensus peut-il trouver son fondement dans une différence de mode d’élection (suffrage universel direct = politique / suffrage universel indirect = gommage politique) ?
Le fait qu’il existe des groupes politiques au sein de l’assemblée délibérante du conseil de la Métropole vient nuancer cet argument. Les groupes se réunissent avant les séances, leur accord est invoqué par le président pour justifier les arbitrages rendus concernant la répartition des postes de vice-président. Il s’agit d’un fonctionnement politique de type parlementaire. Il est identique à celui du conseil régional.
TOUS D’ACCORD SUR TOUT
OU TOUS D’ACCORD POUR TAIRE LES DÉSACCORDS ?
On peut constater que cette identité de vue politique entre Patrick OLLIER (LR), Anne HIDALGO (PS), André SANTINI (UDI), Patrice LECLERC (FDG) ou encore Daniel BREUILLER (EELV) peut se manifester d’autant plus facilement que l’on se trouve en dehors d’une période électorale. D’une part, est-elle durable ? D’autre part, une recherche permanente du consensus n’a-t-elle pas pour effet de mettre de côté les dossiers sur lesquels se manifestent des désaccords ? Cela amène à s’interroger sur les stratégies discursives d’évitement politique. Elles concernent ici une forme de « gouvernement du consensus ». La question mérite une analyse détaillée (2).
LE LOGO DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
noir, rouge et pointillés…
Le logo de la Métropole du Grand Paris
présenté par Patrick OLLIER lors de la séance publique du conseil de la Métropole
le 18 février 2016.
Une version modifiée du logo devrait être élaborée prochainement.
© Photo CAD / BM 2016
Lors de la séance publique du 18 février 2016, Patrick OLLIER a présenté le logo de la Métropole du Grand Paris. Le noir, c’est Paris. Le rouge, c’est la petite couronne. Les petits points, ce sont les autres communes. Patrick BALKANY, conseiller métropolitain, est intervenu pour demander que la couleur du point noir central soit modifiée et devienne un point «bleu de France». Il demeure que le sens de la figuration véhicule l’image d’une centralité, entourée d’une «zone» à la forme peu identifiable, puis d’un éclatement, et enfin d’une dispersion, d’un éparpillement de points…
L’AVENIR EST AU MICROGLOBAL
La Métropole du Grand Paris constitue indéniablement – et contrairement aux annonces faites concernant la fin du «mille-feuille» territorial – une « nouvelle couche » au sein de « l’ordre social territorial », dans le sens où Saskia SASSEN parle dans son étude «Interactions of the technical and the social», d’une « nouvelle couche au sein de l’ordre social, quelque chose qui renvoie aux communautés microglobales » (3). De quoi le clivage politique est-il le produit ? Et d’abord, est-il réductible ? A quoi ? A l’institution ou bien au mode d’élection, c’est-à-dire au type de lien/absence de lien avec le citoyen ?
Le global serait porteur de micro-clivages. Le local serait porteur de structures clivantes, répétant ainsi l’opposition décrite par Saskia SASSEN entre powerfull (plein de pouvoir, puissant) et powerless (sans pouvoir). A méditer d’urgence pour une structure dont la gouvernance et la gestion concernent directement la vie de près de 7 000 000 d’habitants et d’habitantes.
RÉFÉRENCES
1. «Région/Métropole : Patrick OLLIER tue le match», Le Journal du Grand Paris, 18 février 2016. https://www.lejournaldugrandparis.fr/region-metropole-patrick-ollier-tue-le-match/
2. Pour Fabien Desage et David Guéranger (2011) le «gouvernement du consensus» contribue à l’effacement des clivages et à la dépolitisation des enjeux d’action publique.
3. SASSEN Saskia, « Interactions of the technical and the social. Digital formations of the powerful and the powerless », Information, Communication and Society, 15/4, 2012, Routledge, p.455-478.
SASSEN Saskia, « Interactions du technique et du social ». Dispositifs numériques des puissants et des sans pouvoirs », Cahiers Sens public, 2013/1, n°15-16, p. 227-252. (p. 228). Traduction de Gérard Wormser.
La Lettre du lundi de Mieux Aborder l’Avenir
n°184, lundi 22 février 2016
Mention du présent article http ://www.savigny-avenir.info
ISSN 2261-1819 Dépôt légal du numérique, BNF 2016